Le tennis n’est pas seulement un sport de technique, d’endurance et de force mentale. C’est aussi un jeu doté de l’un des vocabulaires les plus étranges et originaux du monde sportif. Entre le zéro appelé love, la séquence de score irrégulière 15–30–40 ou l’annonce finale game, set, match, le langage du tennis est aussi unique que ses traditions. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le tennis utilise des mots si particuliers? Ou d’où viennent vraiment ces expressions?
Comprendre le système de score au tennis peut être déroutant pour les débutants, et même les fans de longue date ignorent souvent l’origine des termes qu’ils entendent tous les jours. Pourquoi parle-t-on de break? Pourquoi le zéro se dit love? Et qu’est-ce qu’un tiebreak, au-delà d’un moment de tension en fin de set?
Dans cet article, nous allons plonger dans l’histoire et le sens des expressions les plus emblématiques du score et de l’argot tennistique, depuis les origines médiévales françaises jusqu’aux tournures modernes nées sur les courts et propagées sur les réseaux sociaux. Que vous soyez joueur occasionnel ou tennis nerd, ce guide vous aidera à décoder l’univers lexical si singulier de ce sport, et peut-être même à impressionner votre prochain partenaire d’entraînement avec quelques anecdotes bien placées.
Alors, la prochaine fois que vous entendrez advantage, deuce ou love-40, souvenez-vous que derrière ces mots se cache bien plus qu’un simple pointage. Préparez-vous à une belle volée d’étymologie.
1. Pourquoi dit-on love au tennis pour indiquer zéro ?
Parmi les nombreuses bizarreries du système de score du tennis, peu sont aussi emblématiques, ou aussi déroutantes, que l’usage du mot love pour signifier zéro. Demandez à un débutant ce que veut dire 15-love, et vous obtiendrez probablement un regard perplexe. Mais pourquoi le tennis utilise-t-il love pour désigner zéro? La réponse, comme souvent, repose à la fois sur la langue et la légende.
La théorie la plus largement acceptée nous ramène au français. Dans les premières formes du jeu, les joueurs français auraient utilisé le mot l’œuf, pour désigner le chiffre zéro, en raison de sa forme ronde, semblable à un zéro sur le tableau de score. Avec le temps, les anglophones ont repris ce terme, mais au lieu d’adopter l’œuf tel quel, ils l’ont transformé phonétiquement en love, un mot plus simple à prononcer et à mémoriser.
Il existe aussi une explication plus romantique, bien que moins fondée linguistiquement. Certains pensent que love symbolise le fait de jouer “par amour du jeu”, suggérant qu’un joueur ayant zéro point continue malgré tout à jouer avec passion. Cette théorie, bien que séduisante, est généralement considérée comme une étymologie populaire.
Il est intéressant de noter que d’autres sports utilisent également des métaphores alimentaires pour désigner le zéro. Par exemple, au cricket, un score nul est appelé duck, abréviation de duck’s egg, encore une fois en référence à la forme de l’œuf.
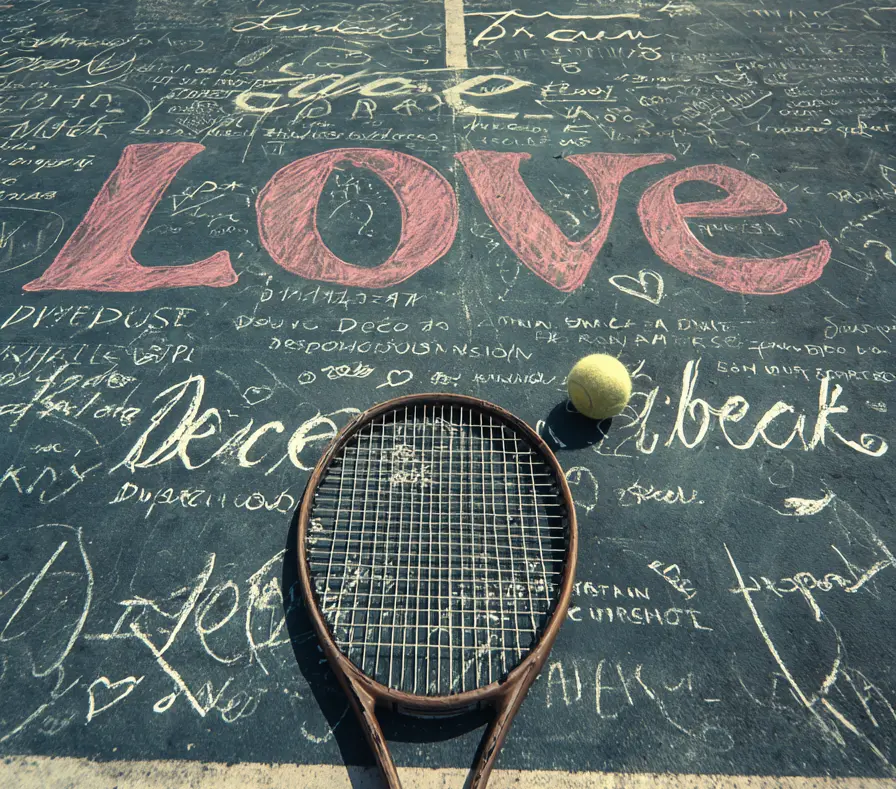
Alors, la prochaine fois que vous entendez 40-love, souvenez-vous qu’il ne s’agit pas d’un mot tendre. C’est le résultat d’une évolution linguistique commencée avec un œuf en France et devenue l’une des expressions les plus célèbres — et les plus mal comprises — du tennis.
2. Le mystère du 15, 30, 40.
Pourquoi pas 45?
Si vous essayez de comprendre comment fonctionne le score au tennis, l’une des premières questions qui se posent est la suivante : pourquoi le score progresse-t-il en 15, 30, 40? Ne serait-il pas plus logique de dire 15, 30, 45?
Cette progression numérique inhabituelle intrigue les amateurs depuis des générations, et même s’il n’existe pas de réponse officiellement confirmée, plusieurs théories intéressantes ont été avancées. L’explication la plus répandue renvoie à l’usage de cadrans d’horloge et de systèmes de comptage médiévaux. Dans les premières formes du jeu – peut-être influencées par le jeu de paume, ancêtre français du tennis moderne – les points auraient été marqués selon les quarts d’heure : 15, 30, 45. Mais à un moment donné, le 45 aurait été remplacé par 40, sans doute pour des raisons de simplicité ou afin d’accélérer l’annonce du score pendant le jeu.

Une autre théorie suggère que le passage à 40 permettait d’intégrer plus naturellement la notion d’avantage. Lors d’un deuce (quand les deux joueurs atteignent 40), le point suivant ne donne pas la victoire immédiate, mais il introduit une phase de jeu à deux points. Si l’on avait gardé 45, cette étape aurait rendu le système plus complexe. Avec 40, il est plus facile d’ajouter une transition avant de conclure le jeu.
On peut également penser que le 45 a simplement été arrondi à 40 avec le temps, par habitude ou commodité. Après tout, le tennis n’a jamais été un modèle de logique mathématique: c’est un sport où les traditions comptent autant que les chiffres.
Ainsi, même si personne ne peut dire avec certitude pourquoi nous ne disons pas 15, 30, 45, la séquence 15–30–40 est devenue l’un des rythmes les plus reconnaissables du sport, et un vestige vivant de ses racines européennes et de sa culture évolutive.
3. Que signifie Deuce au tennis?
Parmi les termes de score qui déconcertent le plus les nouveaux joueurs, deuce occupe une place particulière. Que signifie exactement deuce au tennis et pourquoi l’utilise-t-on?
La réponse se trouve une fois de plus dans l’héritage linguistique, en particulier dans l’expression française à deux le jeu, qui signifie approximativement le jeu est à deux points. Autrement dit, à ce stade, un joueur doit remporter deux points consécutifs pour gagner le jeu. Au fil du temps, cette expression a été raccourcie et anglicisée en deuce, tout en conservant l’idée des deux points nécessaires.
Concrètement, deuce se produit lorsque les deux joueurs atteignent le score de 40–40. À partir de là, l’un doit gagner deux points d’affilée: le premier pour obtenir l’avantage, le second pour conclure le jeu. Si l’adversaire remporte le point suivant, le score revient à deuce et le cycle recommence jusqu’à ce que l’un des deux prenne l’avantage décisif.

Ce qui rend deuce particulièrement intéressant, c’est la manière dont il combine emprunt linguistique et mécanique de jeu. Le mot ne signifie pas littéralement égalité, mais il reflète un moment charnière, où les deux joueurs sont proches de la victoire, tout en devant franchir deux étapes successives.
Dans le tennis amateur, vous entendrez parfois des variantes ou des surnoms pour deuce, comme la boucle infinie ou tout simplement 40 égalité. Peu importe le terme utilisé, deuce reste toujours un point de bascule dans un jeu disputé.
Alors, la prochaine fois que vous êtes coincé dans une série interminable de deuce, souvenez-vous que vous rejouez un rituel vieux de plusieurs siècles, toujours présent aujourd’hui, et l’un des aspects les plus stratégiques et tendus du tennis.
4. Game, Set, Match: anatomie de la victoire
Si vous avez déjà regardé un match de tennis professionnel, vous avez sans doute entendu la phrase : “Game, set, match [Nom du joueur]”. Mais que signifie exactement chaque partie de cette expression? Comprendre la structure de game, set et match est essentiel pour savoir comment on gagne au tennis et comment son système de score crée de la tension au fil du temps.
Décomposons-la.
Un game est l’unité de score la plus petite au tennis. Pour gagner un game, un joueur doit remporter au moins quatre points et mener avec deux points d’écart, d’où les situations de deuce et d’avantage quand cela est nécessaire. Remporter un game contribue à gagner un set.
Un set est une série de games. Dans la plupart des formats professionnels, un joueur doit gagner six games avec au moins deux jeux d’écart pour remporter un set. Si le score atteint 6–6, un tiebreak est généralement joué pour départager les deux joueurs (nous y reviendrons plus tard). La structure des sets peut varier selon les tournois, avec des formats en deux ou trois sets gagnants.
Enfin, un match désigne l’ensemble de la rencontre, composée de plusieurs sets, selon les règles de la compétition. Quand l’arbitre annonce “game, set, match”, il déclare que toutes les étapes nécessaires ont été remportées par un joueur ou une équipe.

Mais d’où viennent ces termes ?
- Game provient de l’anglais ancien gamen, qui signifiait divertissement ou plaisir. Il a très tôt intégré le lexique sportif.
- Set, dans ce contexte, désigne probablement quelque chose de défini ou de complété, une unité d’avancement dans le match.
- Match a des origines françaises (mache, mesche) et désignait une confrontation ou un duel, ce qui convient parfaitement à un sport issu des cours royales.
Comprendre la signification réelle de game, set, match permet non seulement de suivre comment un joueur gagne au tennis, mais aussi de saisir comment ce sport construit la tension à plusieurs niveaux, du plus petit échange jusqu’au point final.
5. Que signifie un Break au tennis, et que veut dire Hold?
Au tennis, tous les games ne se valent pas. Certains ont un poids bien plus important, surtout lorsqu’ils impliquent un break du service. Mais que signifie vraiment breaker son adversaire ? Et que veut dire tenir son service ?
Commençons par les bases.
Quand un joueur sert et remporte le game, on parle de hold. Réussir à garder son service est attendu à la plupart des niveaux, en particulier dans le tennis masculin où la puissance des services rend les retours difficiles. Un hold signifie que le serveur a conservé son avantage.
À l’inverse, si le joueur qui retourne réussit à gagner le game en empêchant le serveur de tenir, on parle de break. C’est un moment crucial dans un match, car prendre le service adverse donne un avantage au score sans même devoir servir soi-même. Dans un set serré, un seul break peut faire la différence entre victoire et défaite.
Le terme est métaphorique : le relanceur brise le rythme, l’habitude et la domination du serveur. Il ne s’agit pas d’enfreindre une règle, mais de rompre les attentes.
En réalité, la bataille entre break et hold est l’un des grands axes tactiques du tennis. Les gros serveurs cherchent à dominer leur mise en jeu et à saisir une occasion de break. Les bons relanceurs, eux, exploitent les secondes balles et mettent la pression dès le début du point pour créer la rupture.
Vous entendrez aussi parfois parler de break immédiat, quand un joueur qui vient de perdre son service parvient à breaker immédiatement en retour. Ce genre d’inversion de dynamique peut complètement changer le cours d’un match.

Et si la tactique et la psychologie jouent un rôle majeur dans ces échanges, le matériel compte lui aussi, surtout dans la façon dont la raquette gère les vibrations à l’impact. De plus en plus de joueurs se tournent aujourd’hui vers des antivibrateurs avancés pour améliorer les sensations et réduire la tension sur le bras.
Si vous souhaitez découvrir des solutions de nouvelle génération, Jetez un œil juste en dessous: nous concevons et fabriquons des antivibrateurs techniques imprimés en 3D, basés sur des métamatériaux, conçus pour absorber sélectivement les fréquences indésirables tout en renforçant la sensation de contact avec la balle.
Découvrez nos antivibrateurs à technologie avancée
La prochaine fois que vous entendrez un commentateur dire ce break change tout, rappelez-vous qu’il ne s’agit pas simplement d’un game remporté, mais d’une prise de contrôle sur le set, sur le rythme et parfois sur tout le match.
6. Ace! Le service gagnant
Peu de choses au tennis procurent autant de satisfaction, pour le joueur comme pour le spectateur, que le son net d’un service imparable qui passe sans que l’adversaire ne touche la balle. C’est ce qu’on appelle un ace, l’un des coups les plus décisifs et spectaculaires du jeu. Mais qu’est-ce qu’un ace exactement au tennis, et d’où vient ce terme ?
Un ace se produit lorsqu’un joueur réalise un service et remporte le point directement, sans que le retourneur ne touche la balle avec sa raquette. C’est la démonstration ultime de puissance ou de placement, et c’est souvent une arme clé pour conclure un game ou inverser une dynamique dans un set disputé. Plus un joueur réussit d’aces, plus il lui est facile de conserver son service.
Mais pourquoi utilise-t-on le mot ace ?
Le terme vient du monde des cartes à jouer, où l’as est souvent la carte la plus forte du jeu. Dans le sport, il en est venu à désigner une action parfaite ou irrésistible, à laquelle l’adversaire ne peut répondre. Le tennis a adopté ce mot au début du XXe siècle, et il est resté car il exprime parfaitement l’idée d’un service net, sans réponse possible.
Les meilleurs joueurs comme John Isner, Ivo Karlović et Roger Federer sont connus pour réaliser des centaines, voire des milliers, d’aces en une saison. Certains matchs peuvent se transformer en véritables festivals d’aces, où les deux joueurs comptent surtout sur leur service pour éviter les longs échanges.

Il est intéressant de noter que tous les aces ne dépendent pas uniquement de la puissance brute. Le placement, l’effet et le timing peuvent être tout aussi décisifs. Un service slicé bien dirigé vers l’extérieur peut être aussi efficace qu’une frappe à 220 km/h dans l’axe.
En résumé, l’ace n’est pas qu’un simple point de plus: c’est un geste psychologique, une affirmation de contrôle et, bien souvent, un moment digne d’être rejoué au ralenti. La prochaine fois que vous entendrez “ace !” retentir sur le court, sachez que vous assistez à l’une des micro-victoires les plus marquantes du tennis.
7. Bagels et Breadsticks: quand la nourriture s’invite dans le score
Seul au tennis, le tableau d’affichage peut ressembler à une boulangerie. Si vous avez déjà entendu un commentateur dire qu’un joueur a servi un bagel ou qu’il a reçu un breadstick, vous êtes entré dans le monde du vocabulaire le plus savoureux du tennis. Mais que signifient vraiment ces termes, et d’où viennent-ils ?
Un bagel correspond à un set gagné 6–0. L’explication vient de la forme : le zéro ressemble à un bagel rond. Ainsi, lorsqu’un joueur ne remporte aucun game dans un set, on dit qu’il a été “bagelisé”. C’est une manière humoristique de décrire ce qui est en réalité une véritable humiliation, et cela reste souvent un moment difficile à avaler pour le joueur concerné.
L’origine du terme est généralement attribuée au circuit américain, particulièrement dans les années 70 et 80, lorsque la culture des surnoms et de l’humour sportif s’est développée. Le célèbre John McEnroe est d’ailleurs souvent cité comme l’un des joueurs ayant popularisé ce terme à ses débuts.
Ensuite vient le breadstick, qui décrit un set terminé 6–1. Là encore, la logique est visuelle : le chiffre un évoque un bâton de pain. Moins sévère qu’un bagel, mais cela indique tout de même un déséquilibre net dans la performance.
Pour pimenter un peu les choses, les joueurs et les fans combinent parfois les deux : un match gagné 6–0, 6–1 devient alors un menu bagel-breadstick. Et quand le score est 6–0, 6–0, on parle même d’un double bagel, une expression partagée entre ironie et compassion.
Fait amusant, ces termes sont devenus si répandus que les commentateurs de l’ATP et de la WTA les utilisent régulièrement en direct, sans même les expliquer. On les retrouve aussi sur les réseaux sociaux, dans des mèmes, ou même dans les blagues entre joueurs après un match.

Ces métaphores culinaires peuvent sembler absurdes au premier abord, mais elles sont aujourd’hui des éléments à part entière du langage culturel du tennis. Et dans ce sport, un bagel ne parle pas de glucides, mais de domination, de stratégie et parfois de pure cruauté dans le score.
8. Tiebreaks et Super Tiebreaks.
comment ces termes sont nés
Le tennis est peut-être un sport chargé de traditions, mais lorsqu’il s’agit d’éviter des matchs interminables, même les disciplines les plus anciennes doivent innover. C’est ainsi qu’est né le tiebreak, une invention relativement récente qui est devenue une partie essentielle de la façon dont un match se conclut aujourd’hui. Mais qu’est-ce qu’un tiebreak, et d’où vient ce mot ?
Un tiebreak est un format spécial de score utilisé lorsque les joueurs atteignent 6–6 dans un set, conçu pour décider rapidement qui remportera cette manche. Contrairement aux games classiques, où il faut deux jeux d’écart, le tiebreak se joue comme une mini-partie : généralement jusqu’à 7 points, avec deux points d’écart minimum. Le joueur qui le gagne remporte le set sur le score de 7–6.
Le mot est explicite : il sert à briser l’égalité. Simple, efficace, clair. Le tiebreak a été officiellement introduit dans le tennis professionnel au début des années 1970, en grande partie grâce à l’innovateur américain James Van Alen, qui était frustré par les sets à rallonge et les durées de matchs imprévisibles.
Fait curieux : le format original était encore plus dramatique. Appelé sudden death tiebreaker, il se jouait en 5 points, sans marge d’erreur. Un seul point à 4–4 pouvait tout décider. Avec le temps, ces formats extrêmes ont été remplacés par des versions plus équilibrées, comme celles en vigueur aujourd’hui.

Il existe aussi le super tiebreak, également appelé match tiebreak. Ce format est surtout utilisé dans les matchs de double ou les tournois à durée réduite, en remplacement d’un troisième set. Les règles sont simples : il se joue en 10 points, avec deux d’écart. C’est une manière rapide et intense de clore un match sans épuiser les joueurs.
Même si les puristes n’en sont pas toujours fans, le tiebreak et le super tiebreak ont rendu le tennis plus lisible et plus gérable, surtout dans les circuits professionnels aux calendriers chargés.
Aujourd’hui, des expressions comme “il a gagné le tiebreak 7–4” ou “ils ont conclu sur un super tiebreak” font partie du langage courant, du circuit junior jusqu’aux Grands Chelems. Et tout comme deuce ou break, tiebreak n’est plus juste une règle : c’est devenu un élément stratégique essentiel du tennis moderne.
9. Argot du tennis.
Moonballs, Tweeners et autres termes expliqués
Au-delà du score officiel et des termes structurés, le tennis a développé un vocabulaire propre, riche et souvent amusant. C’est là que la créativité s’exprime : sur le court, dans les vestiaires et sur les réseaux sociaux. Des moonballs aux tweeners, ces expressions donnent de la couleur au récit et permettent aux joueurs de décrire des situations que le langage formel ne peut pas saisir.
Commençons par la moonball. Une moonball est un coup haut, avec beaucoup de topspin et une trajectoire arquée, souvent utilisé pour relancer l’échange ou déstabiliser un adversaire agressif. Le terme vient du fait que la trajectoire de la balle rappelle l’orbite de la lune. Les joueurs qui utilisent fréquemment cette tactique sont appelés moonballers, et même s’ils sont parfois sous-estimés, leur constance peut rendre fous les frappeurs puissants.
Ensuite vient le tweener, l’un des coups les plus spectaculaires du tennis. Le tweener (abréviation de between-the-legs shot) s’exécute lorsqu’un joueur court après un lob et frappe la balle entre ses jambes, dos au filet. C’est à la fois une solution d’urgence et une démonstration d’habileté. Quand c’est bien réussi, le public explose.

Parmi les autres termes populaires de l’argot tennistique, on trouve :
- Dead net: lorsqu’une balle touche la bande du filet et tombe juste derrière, hors d’atteinte.
- Jammer: un service ou coup dirigé vers le corps de l’adversaire, difficile à renvoyer naturellement.
- Serve-and-volleyer: un joueur qui monte au filet juste après avoir servi. C’est un style classique, devenu rare dans une ère dominée par le jeu de fond de court.
On entend aussi des expressions comme “peindre la ligne” (pour un coup parfait sur la ligne), “shank” (un coup complètement décentré), ou encore “bag check” (façon sarcastique de dire qu’un joueur a si mal joué qu’il devrait déjà plier bagage).
Beaucoup de ces termes varient selon les régions ou cultures. L’argot australien, par exemple, est particulièrement coloré, tandis que le tennis universitaire américain a son propre lexique. Dans tous les cas, l’argot du tennis est un langage avec une personnalité forte. Il reflète l’humour, la créativité et la psychologie du jeu.
Alors, que vous regardiez un échange de moonballs ou un tweener parfaitement exécuté, souvenez-vous que vous assistez à un tennis qui parle son propre dialecte, en constante évolution et toujours divertissant.
10. Du court à la culture.
Quand le tennis entre dans le langage courant
Le tennis ne vit pas uniquement entre les lignes du terrain. Il s’est progressivement infiltré dans les réunions de travail, les discours politiques et les conversations quotidiennes, grâce à la force expressive de son vocabulaire. Au fil du temps, de nombreux termes tennistiques sont devenus des métaphores universelles bien au-delà du sport.
Prenons l’expression game, set, match. Utilisée à l’origine pour annoncer la fin officielle d’un match, elle est désormais employée pour exprimer une victoire totale et irréversible dans n’importe quelle confrontation. On l’entend en politique (“Ce débat, c’était game, set, match”), dans le monde des affaires (“Contrat signé, game, set, match”), ou même dans des discussions personnelles. C’est une manière d’exprimer une conclusion définitive et incontestable.
Autre exemple : le match point, ce moment où un joueur n’est plus qu’à un point de la victoire. Dans le langage courant, match point est utilisé pour décrire une situation critique et pleine d’enjeu, où tout peut se jouer en un instant. Des titres comme “Match point pour la planète” ou “Match point pour la réforme” sont de plus en plus fréquents.
Même le concept de break point a été adopté pour évoquer un tournant stratégique ou un point de bascule décisif. Dans une négociation, il n’est pas rare d’entendre “On est au break point, il faut agir maintenant”.

Ces expressions fonctionnent car la structure même du tennis — avec ses scores en couches, ses renversements de rythme et ses points décisifs — reflète beaucoup de dynamiques humaines, qu’il s’agisse de conflits, de tensions ou de résolutions.
Cette influence ne se limite pas au langage. L’esthétique raffinée du tennis, sa précision technique et son héritage culturel ont contribué à diffuser ses codes dans la mode, la publicité et les médias. Des accessoires comme le tennis bracelet ou la polo Lacoste trouvent leur origine sur les courts avant de devenir des icônes du quotidien.
Alors, la prochaine fois que quelqu’un dit c’est game, set, match, ne pensez pas uniquement à un court central. Pensez à la manière dont le tennis a marqué notre culture, pas seulement avec des raquettes et des échanges, mais aussi avec les mots que nous utilisons pour parler de compétition, de pression et de victoire.
Conclusion: Écoutez le langage du tennis
De love et deuce à bagel, ace et match point, le langage du tennis n’est pas simplement un ensemble de termes liés au score. C’est un réseau riche d’histoire, d’humour et de symboles culturels. Chaque mot raconte une histoire : héritages du passé, trouvailles modernes ou créations spontanées des joueurs eux-mêmes.
Pour les débutants, ces mots peuvent sembler étranges au départ. Mais pour les passionnés et les joueurs expérimentés, ils deviennent familiers, un code partagé qui unit la communauté tennistique mondiale, à travers les générations et les frontières.
Ce qui rend ce vocabulaire si fascinant, c’est qu’il dépasse les limites du terrain. Il s’est glissé dans notre langue quotidienne, il a influencé la culture populaire, il a coloré la manière dont nous parlons de stratégie, de rivalité et de moments décisifs dans d’autres domaines de la vie.
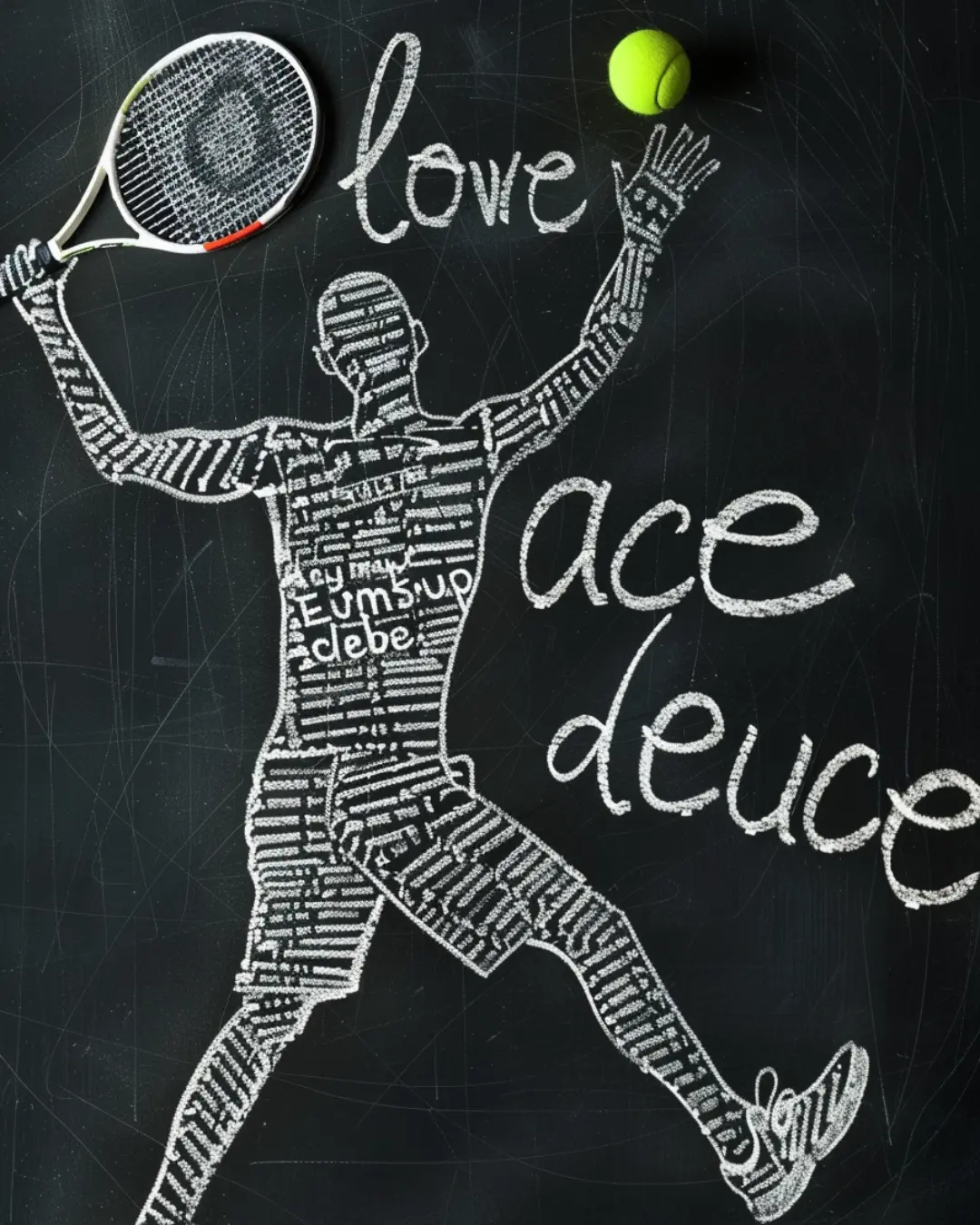
Alors, la prochaine fois que vous entendez game, set, match ou que vous vous retrouvez dans une situation de deuce au travail, prenez un instant pour apprécier l’élégance de ce langage. Le tennis ne s’exprime pas uniquement avec des raquettes et des frappes : il s’exprime aussi par ses mots.
🎾 Envie de découvrir plus d’histoires étonnantes sur le tennis ?
Explorez notre article sur les secrets de la terre battue, surface la plus singulière du tennis ou découvrez comment prévenir le coude du joueur de tennis.
Et si vous avez aimé cette plongée dans le vocabulaire du tennis, partagez-la avec d’autres passionnés ou laissez-nous un commentaire avec votre mot préféré.